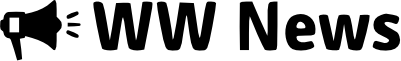" Campagne ", de Raymonde Vincent : la nature qui donne et qui prend
L’écrivaine Raymonde Vincent, en 1978. ULF ANDERSEN/AURIMAGES
« Campagne », suivi de « Se souvenir de ma mère » (inédit), de Raymonde Vincent, préface de Renan Prévot, Le Passeur, « Les pages oubliées », 360 p., 19 €.
Première œuvre étincelante de Raymonde Vincent (1908- 1985), Campagne (Stock, 1937) est une pépite paradoxale. Réédité aux éditions Le Passeur, ce roman à la grâce enchanteresse rafla le prix Femina au nez et à la barbe de Robert Brasillach et d’Henri Bosco, avant d’être salué par Colette, Paul Claudel et bien d’autres. A l’intensité des entrées en littérature, il allie la virtuosité des coups de maître, avec un éclat d’autant plus inédit qu’on le doit à une Berrichonne qui n’avait reçu, pour toute éducation, que le catéchisme. Elle écrira huit autres livres avant de tomber dans l’oubli.
Est-ce le fait de ne pas être allée à l’école ? Débarquée à Paris à 17 ans, posant pour des artistes, dont Giacometti, et devenue l’épouse du critique et traducteur Albert Béguin, elle fait couler la vie paysanne dans ses pages d’une écriture cristalline, qui jaillit en une sidérante apparition. Epousant les volutes du destin, elle décrit, dans un « coin reculé du Berry », le quotidien de fermiers qui « s’imprim[e] sur l’écran des saisons » : « premiers crépuscules d’avant-printemps », « arrière-automne », et aussi la première guerre mondiale, dont la déflagration rattrape cette mosaïque de faucheurs et bergers. La narration se dilate et se resserre en un flamboyant vibrato, palpitant au diapason de Marie, jeune fille de 16 ans recueillie avec sa grand-mère chez des cousins, métayers sur un vaste domaine.
Extases et déchirures des personnages se déploient avec une puissance émotive stupéfiante. Leur relief donne à cette succession de tableaux la verve de miniatures expressionnistes qui font entrer le lecteur dans la page. Le nouveau monde de Marie est une poupée gigogne : lovée dans un bois de lilas, la maison des fermiers borde des champs en enfilade, dans le parc d’un château. La nature habitée, sacralisée, en est le personnage principal, ordre panthéiste qui relie êtres et saisons, terre et végétaux – « campagne » sans article du titre, cœur ardent du roman. C’est, aussi, celle que l’on bat, lieu de retraite et champ de bataille intérieur.
La forêt, un refuge où traverser peines et joies
Témoin des événements, miroir où se reflète ce qui déborde, elle prend part à l’action : à la mort de sa femme, le maître de la ferme erre deux mois dans les bois. Quand elle est trop inquiète, leur voisine a besoin d’y entrer ; Marie et sa grand-mère y déversent leurs pleurs ; son cousin, lui, fait semblant de s’y promener. Les « profondeurs sous-marines » de la forêt offrent un refuge où traverser peines et joies, les rendre réelles. Comme celui du Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier (1913), le domaine est un espace de révélation, lieu de scission et de transformation où raison et déraison se battent en duel.
Il vous reste 45.43% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Source: Le Monde