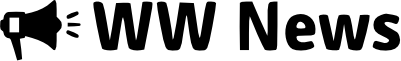Jacques Rozier, mort de l’insulaire du cinéma français
Son itinéraire farouche, indépendant et inadapté à toute forme d’obéissance a fait de lui un réalisateur en perpétuel décalage. Jacques Rozier s’est éteint le 2 juin, à l’âge de 96 ans.
Jacques Rozier à la Cinémathèque, à Paris, en 2019. SOLAL/SIPA / SOLAL/SIPA
Par Guillemette Odicino Partage
Envoyer par email
Copier le lien
Il aura fallu que Jacques Rozier meure, ce 2 juin à 96 ans, pour que peut-être, enfin, on cesse d’ignorer celui qui, en seulement quatre longs métrages, compta parmi les plus grands cinéastes français. Un artiste hors du temps ou, au contraire, tellement dans l’instant que chacun de ses films passe pour une parenthèse suspendue, en perpétuel décalage horaire, entre terre et mer.
Son itinéraire de farouche indépendant, de fugueur et, pour tout dire, d’inadapté à toute forme d’obéissance, commence de manière plutôt classique. Né en 1926, le jeune homme, avant tout fasciné par la caméra en tant qu’objet, fait l’Idhec dans les années 1950. Il en sort pour réaliser des courts métrages qui fleurent bon la relève d’un Jean Vigo : Rentrée des classes (1956) où, premier indice d’évasion à venir, un gamin balance son cartable dans la rivière et délaisse ses condisciples pour le récupérer en suivant le courant. Puis Blue Jeans (1958), ode déjà iodée à la drague, et très Nouvelle Vague avant l’heure, qui attire d’ailleurs l’attention d’un critique nommé Jean-Luc Godard.
Las, dès le premier long métrage, Adieu Philippine (1962), les choses se gâtent : le film devait sortir deux ans plus tôt, peu de temps après A bout de souffle, mais son producteur Georges de Beauregard s’est désolidarisé du projet, expliquant ce qu’il nomme « l’affaire Rozier » dans les pages des Cahiers du cinéma : « Il y a des gens qui comprennent le problème de l’argent, lui non. On ne fait pas un film en se désintéressant totalement des questions matérielles. » Rozier, si. Rozier avec un « z » comme zut, comme un pied de nez à l’industrie. Rozier va à son rythme, et Du côté d’Orouët sort six ans plus tard, en 16 mm, grâce à quelques subsides de l’ORTF pour lequel il avait réalisé, en 1964, un numéro de Cinéastes de notre temps sur… Jean Vigo.
Adieu Philippine, Du côté d’Orouët : deux films de vacance, avec ou sans s, qui ne ressemblent à aucun autre, entre marivaudage yé-yé, utopie amoureuse soixante-huitarde, chagrins pas si graves, filles et guêpes sur la plage, fous rires à cause d’un pot de chambre, et le Z de Bernard Ménez dans le deuxième. Des chroniques doucement mélancoliques et farceuses dans lesquelles flotte un drôle d’air, comme si le cinéaste avait inventé sa propre météo : un été d’arrière-saison quand le bleu, et les sentiments, virent délicatement au gris.
Avec lui, il y a le temps qu’il fait et le temps qu’il met pour le filmer. En 1976, c’est au tour d’autres zozos de comédie, plus ou moins débutants (Pierre Richard, Maurice Risch, Jacques Villeret), d’accepter, par amitié, de venir dériver dans les eaux de Rozier : Les Naufragés de l’île de la Tortue, qui ne sortit en salles que trente ans après son tournage, débute dans une agence de voyages, puis le scénario, qui tient sur un ticket de métro, s’improvise autour d’une île, avec pour slogan « Robinson, démerde-toi » ! Ce n’est pas un film, c’est un voilier, burlesque à la proue, angoisse existentielle à la poupe, en partance pour un îlot de cinéma sans comparaison.
Le sablier s’écoule encore longtemps et un producteur aventureux se profile à l’horizon : en 1986, grâce à Paolo Branco, Rozier met le cap sur Maine Océan, considéré comme son chef-d’œuvre. Comment une danseuse brésilienne venue « voir à quoi ressemble l’autre côté de l’Atlantique » mais qui n’a pas composté son billet de 18h28 à destination de Saint-Nazaire, va transformer un contrôleur de la SNCF (encore Ménez) en roi de la samba sur l’île d’Yeu… Impossible (depuis Jacques Tati ?) de trouver aussi dingue et poétique que cet éclat de cinéma insulaire.
À lire aussi : Jacques Rozier à la Cinémathèque, un cinéaste hors des sentiers battus
Entre ces quelques perles, qui regardent toutes vers la mer à l’exception de l’inédit Fifi Martingale (2001), situé dans les coulisses d’une tournée théâtrale, Rozier s’était lancé en 1975 dans Nono Nénesse, coréalisé avec Pascal Thomas. Dans cette pochade inspirée de Brats de Laurel et Hardy, Bernard Ménez, Jacques Villeret et Maurice Risch jouent des bébés, puis des petits garçons, dans un décor construit à l’échelle. Nono Nénesse se voulait le pilote d’une série pour la télévision qui, bien sûr, n’aboutira pas.
“Si je n’étais pas cinéaste ? J’aurais été marin. Marin comme les marins de Pagnol, pour traverser le Vieux-Port.”
De ses débuts, on retiendra aussi un précieux documentaire en deux parties (Paparazzi et Le Parti des choses), dans lequel il filmait la traque de Brigitte Bardot par les chasseurs d’images et ses rapports avec Godard sur le tournage du Mépris à Capri, en 1963. Il fallait bien un flibustier de cinéma pour comprendre comment naviguent ensemble une fille du vent et le pape de la Nouvelle Vague.
« Si je n’étais pas cinéaste ? J’aurais été marin. Marin comme les marins de Pagnol, pour traverser le Vieux-Port. » Au micro de Serge Le Péron et Guy Girard pour l’émission Cinéma, cinémas en 1986, le cinéaste disait le vrai sur un ton léger : la fiction comme mini-escapade, comme échappée belle, avec une tendre indocilité en étendard, au risque de voir la terre trembler sous ses pieds – en juillet 2021, sur Facebook, un message de certains de ses derniers soutiens appelait à aider le grand cinéaste de 94 ans, sur le point d’être expulsé de son logement. Cette fois, les contrôleurs en tout genre peuvent bien aller apprendre la rumba, c’est pour de bon que Rozier a largué les amarres.
Source: Télérama.fr