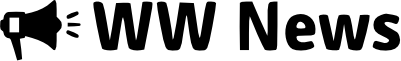Le thiéboudiène, délicieux monument sénégalais
Des plats de thiéboudiène à Dakar en décembre 2021. CARMEN ABD ALI / AFP
Aussi célèbre que les cars rapides dakarois ou le baobab, le thiéboudiène (également orthographié ceebu jën et souvent appelé « thiep ») est au Sénégal ce que « les pâtes sont à l’Italie et les sushis au Japon », selon le chef sénégalais Omar Ngom : un emblème ! Plat du quotidien comme des grands événements – la différence résidant surtout dans la qualité des produits –, le thiéboudiène est un incontournable de la cuisine sénégalaise.
Comme de celle d’Astou Diop : « Au début de notre mariage, on a dû négocier, sinon nous aurions mangé du thiep tous les jours, tellement Bachir aime ce plat ! », plaisante cette habitante de Saint-Louis, dans le nord du pays, attablée devant… un thiéboudiène.
Lire aussi : La cuisine africaine, nouvelle tendance ? Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections Pour ajouter l’article à vos sélections
identifiez-vous S’inscrire gratuitement
Se connecter Vous possédez déjà un compte ?
C’est dans cette ville, capitale de l’Afrique occidentale française (AOF) entre 1895 et 1902, que fut signé, au XIXe siècle, l’acte de naissance de ce plat, autour de la légende de Penda Mbaye. La coiffeuse, qui cuisinait également sur le marché, « aurait eu l’idée de malaxer des tomates cerises revenues avec des oignons, donnant au thiep cette belle couleur rouge », rapporte Fatima Fall Niang, directrice du Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) à Saint-Louis. Bien que son existence n’ait jamais été confirmée, l’appellation « ceebu jën Penda Mbaye » persiste encore de nos jours pour désigner le plat original.
« Un plat complet et riche »
« Le thiep saint-louisien, c’est un riz rouge, coloré par les tomates, du poisson, et c’est un plat qui fait la part belle aux légumes, car nous sommes à l’embouchure du fleuve Sénégal, une région où l’on pratique le maraîchage. Il est complété par du suweer (aussi appelé diaga), c’est-à-dire des boulettes de poisson, souvent du thon rouge ou de la sardinelle, auquel certains ajoutent des crevettes. A part, on réalise également une sauce au tamarin. C’est un plat complet et riche », détaille Marie-Caroline Camara, Saint-Louisienne par son père et gérante de la maison d’hôtes Au Fil du Fleuve, dans cette ville.
Le riz, brisé, et le poisson, farci avec un mélange d’ail, de persil et d’oignon vert, sont les ingrédients essentiels du plat. Mais, d’une région et d’une ethnie à une autre, les recettes diffèrent sensiblement. « Les Lebou [une communauté de pêcheurs, majoritaire sur la presqu’île de Dakar] ont ajouté le yet et le guedj, des poissons et crustacés séchés », précise Astou Diop, qui ajoute en souriant : « Il y a une orthodoxie saint-louisienne qui n’accepte pas les modifications. »
Tous les ingrédients sont cuits dans une même marmite, ajoutés progressivement selon le temps de cuisson de chacun, afin que le plat mijote pour libérer les différentes saveurs durant environ trois heures. Ce savoir-faire est transmis de mère en fille, mais depuis une dizaine d’années des hommes s’en emparent lors d’événements comme des fêtes religieuses.
Fruit du métissage
Le « riz au poisson » (traduction littérale du nom du plat) a une forte valeur sociale. Partagé autour d’un bol, il appelle à la convivialité et à la transmission des valeurs chères au pays de la teranga (« hospitalité » en wolof). « Autrefois, il permettait également l’éducation : une personne âgée distribuait aux enfants des portions de légumes, de poisson et égalisait la quantité de riz afin que tout le monde soit au même niveau. On enseignait également les manières de se bien comporter », explique Fatima Fall Niang, coautrice avec Alpha Amadou Sy de l’ouvrage Le Ceebu Jën, un patrimoine bien sénégalais.
Devenu plat national, le thiéboudiène est le fruit d’un métissage et le résultat de l’histoire coloniale. Importé depuis les colonies d’Indochine, avant qu’il ne soit cultivé localement, le riz a remplacé le mil ou le fruit du baobab qui accompagnaient auparavant le poisson. « Le thiep a toujours été international : on y retrouve les quatre continents avec les légumes d’Europe, le riz d’Asie, les oignons des Etats-Unis et le poisson du Sénégal, seul ingrédient vraiment local », développe-t-elle. Les communautés se sont ainsi approprié cette recette au point de l’imposer comme « patrimoine gastronomique authentiquement sénégalais ».
C’est pour ancrer ce patrimoine, et devancer le Nigeria et le Ghana qui convoitaient la paternité de ce qu’ils nomment jollof rice, qu’une demande a été déposée en 2020 à l’Unesco. « Il y a eu un fort engagement de la communauté de Saint-Louis : les pêcheurs, les chercheurs, les élus, etc. L’engouement a été considérable », se rappelle la directrice du CRDS, chargée de coordonner le dossier. Ce plat qui fait la fierté des Sénégalais a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel en décembre 2021.
La recette, ambassadrice de la cuisine sénégalaise, peut agir, selon Fatima Niang Fall, comme un agent de diplomatie gastronomique pour promouvoir le pays, mais aussi la ville de Saint-Louis. « Il ne faut pas s’arrêter à la consommation du thiep comme quelque chose de culturel, cela doit servir à tous les secteurs : économie, sanitaire et tourisme », défend-elle.
Impossible de le revisiter ?
Dans cette optique, une résidence de création et de design culinaire appelée Waañ Wi (« la cuisine »), soutenue par la villa Saint-Louis Ndar, l’ambassade de France et le réseau Chefs in Africa, s’est tenue du 13 au 19 mars à Saint-Louis. Orchestrée par Table Pana, une structure organisant des dîners privés à Dakar, elle s’était donné pour objectif de mettre en lumière des produits du terroir cuisinés par trois chefs internationaux.
« Les chefs de la diaspora africaine ont le vent en poupe : on fait découvrir une autre gastronomie, un métissage entre produits du continent, comme le mil, le fonio, et codes de la cuisine occidentale », raconte Senda Waguena, chef togolais qui a mis le thiéboudiène à la carte de son restaurant parisien, Jujube. Le Sénégalais Omar Ngom se félicite de voir désormais ce plat s’imposer dans des restaurants, y compris gastronomiques, et imprimer sa marque mondialement.
Pour ces deux chefs, impossible de le revisiter. « On ne peut pas toucher à ce monument de notre patrimoine », affirme, catégorique, Omar Ngom. Pour sa part, Julie Basset, cheffe privée et designer culinaire française participant également à la résidence, se voit bien proposer une version décomposée du plat, à laquelle elle pourrait ajouter de petites touches personnelles.
Reste que, si les eaux du Sénégal figurent parmi les plus poissonneuses du monde, la surpêche réduit fortement ses ressources halieutiques, provoquant une hausse des prix. « Le thiof [“mérou”] est devenu un luxe », soupire Bachir Diop. Les usines de farine et d’huile de poisson participent également au phénomène : en achetant massivement des sardinelles pour fabriquer des produits destinés à la pisciculture, elles privent les ménages de ce poisson très consommé et peu onéreux. Au-delà du thiéboudiène, c’est surtout la sécurité alimentaire qui est menacée, le poisson étant le principal apport en protéines des Sénégalais.
Source: Le Monde