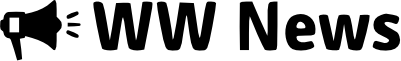Copland, quand Stallone réussissait un contre-emploi de rêve
Ce dimanche 14 mai à 20h50, Arte diffuse le film policier de James Mangold, avec Sylvester Stallone en shérif léthargique, l’un de ses meilleurs rôles. Attention, ce texte révèle certains éléments de l’intrigue.
Sylvester Stallone, en shérif rédempteur d’une cité-dortoir du New Jersey, dans « Copland ». Miramax
Par Nicolas Didier Partage
Envoyer par email
Copier le lien
En 1997, Copland n’est que le deuxième long métrage de James Mangold – 33 ans au moment de la sortie –, après le méconnu Heavy (1995). Entre conte moral westernien et film de gangsters scorsésien, il met en scène la rédemption du shérif d’une cité-dortoir du New Jersey peuplée de flics de New York. Léthargique, atteint d’une symbolique semi-surdité, le héros reste aveugle, plus ou moins volontairement, à la corruption des collègues, dont il doit affronter au quotidien le paternalisme et le mépris de classe – il leur est inférieur, dans la hiérarchie des forces de l’ordre.
Joué par Sylvester Stallone, le personnage se nomme Freddy Heflin, en référence à l’acteur Van Heflin (L’Homme des vallées perdues, 3h10 pour Yuma), habitué à être ridiculisé par plus fort que lui. Autre inspiration pour Mangold lors de l’écriture du scénario : la performance de Marlon Brando dans Sur les quais (Elia Kazan, 1954). Roi musclé du box-office dans les années 1980, Stallone cherche alors à trouver un second souffle, après des résultats en dents de scie au début des années 1990. En matière de films d’action, il alterne succès (Cliffhanger) et bides (Judge Dredd). Et, contrairement à son rival Arnold Schwarzenegger, il rate sa revitalisation par la comédie – même si le parodique Demolition Man (1993) reste sous-estimé.
Loser magnifique
Malgré l’opposition initiale du cinéaste, qui voit en Stallone une puissance colossale, à l’opposé du protagoniste, il est finalement le premier comédien à rejoindre le projet, après que son agent lui a parlé du script à Sundance. Dans la foulée, il prend une vingtaine de kilos, grâce à un régime à base de beurre de cacahuète, de pain perdu et de pancakes. Jusqu’à ce que, de son propre aveu, il n’arrive plus à se pencher. Objectif : perdre ses muscles athlétiques, qu’il considère comme son armure. Sur le tournage, il adopte ensuite une démarche de tortue : bras ballants, tête rentrée dans les épaules, regard tombant.
L’acteur prend, dès l’entame, des allures de loser magnifique. En train de descendre des bières au bar (en tongs), il sort dans la rue chercher des pièces en ouvrant un parcmètre afin de satisfaire son addiction au flipper. La démythification culmine avec une scène de réveil matinal, où il apparaît comme un gros bébé en tee-shirt et caleçon, ventre à l’air, sparadrap sur le nez. Coupée dans la version pour les salles par la production Miramax – les frères Weinstein sont aux manettes –, elle sera ensuite rétablie dans la version « director’s cut », sortie en DVD au milieu des années 2000. L’inquiétude de la production vient, à l’époque, des premières projections tests : la performance de Stallone pourrait sembler trop iconoclaste pour les fans et trop opportuniste pour les critiques.
Par son art de l’esquisse, Mangold multiplie les instants de grâce, dont une séquence bouleversante, qui montre Stallone-Heflin assoupi sur son canapé, bercé par Drive All Night, de Bruce Springsteen, tournant sur sa platine vinyle. Plus tard, une autre belle scène à domicile se jouera au son de Stolen Car, également issue de l’album The River (1980). Il y a quelque chose d’émouvant à voir l’homme le plus fort de la décennie précédente devenir à ce point fragile. Sa stature de costaud durant l’ère Reagan avait occulté la vulnérabilité originelle de ses héros, y compris les plus célèbres, Rocky (1976) et Rambo (1982).
L’histoire de Copland renvoie, bien sûr, à celle de la carrière de Stallone, jamais admis au panthéon des grands acteurs hollywoodiens. Sur le tournage, il règne une franche entente et une compétitivité créative entre stars. « La première scène avec De Niro, j’ai dû la répéter cinquante mille fois dans ma tête. J’attendais ce moment depuis vingt ans », racontait-il au Premiere américain, l’été 1997. Aux flots de paroles testotéronées, Stallone oppose un jeu silencieux, qui s’appuie sur les regards et les gestes. Sans doute parce qu’il incarne le personnage le moins médiocre moralement, il parvient à mettre à l’amende ses partenaires (Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert Patrick), ce qui n’est pas la moindre des prouesses. Jusqu’à ce qu’il prenne le dessus durant une impressionnante fusillade au ralenti, en ouïe subjective.
« James Mangold m’a forcé à explorer des recoins sombres et des pièces pleines de toiles d’araignée où je n’étais jamais allé », confiait Stallone dans un making-of promotionnel, lui qui avait été le souffre-douleur de ses camarades durant l’enfance. Hélas, le succès modeste de Copland ne parvient pas à relancer la carrière du comédien, qui enchaîne les films d’action bas de gamme durant encore une décennie. « Je n’ai jamais travaillé avec un meilleur réalisateur que James Mangold. Et j’ai adoré le film. Mais l’effet a été l’inverse de celui escompté. Malgré les bonnes critiques, le box-office décevant a conforté l’opinion selon laquelle mon moment était passé, comme celui du dodo ou du tigre de Tasmanie », expliquait-il à Variety en 2019. Sa renaissance viendra avec le retour de ses champions, Rocky Balboa en 2006 et John Rambo en 2008, puis avec la franchise « méta » Expendables, à partir de 2010. Que Copland soit un come-back raté – commercialement – renforce, un peu plus, la beauté du geste.
Source: Télérama.fr