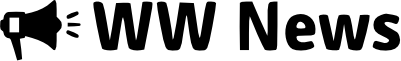"The Zone of Interest", ou comment filmer l'horreur de la Shoah sans la montrer
Temps de lecture: 5 min
Que peut-on et doit-on montrer de la Shoah à l'écran? De Nuit et Brouillard (1956) jusqu'au biopic Simone (2022) en passant par Shoah (1985), le débat refait surface à chaque nouvelle œuvre tentant de s'emparer du sujet. Si la transmission de la mémoire à travers la culture reste essentielle, les histoires fictionnelles sur l'Holocauste sont souvent accusées de mauvais goût ou d'indécence.
En dénonçant le «travelling de Kapò» en 1961, Jacques Rivette s'était indigné du recours aux artifices du cinéma pour raconter la mort d'une détenue. Le prix Nobel de la paix Elie Wiesel écrivait quant à lui en 1989 dans le New York Times: «De même que personne ne pouvait imaginer Auschwitz avant Auschwitz, personne ne peut plus à présent raconter Auschwitz après Auschwitz.»
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne
Pour autant, les cinéastes ne cessent de se débattre avec la représentation de cette période historique. En 2015, László Nemes présente à Cannes Le Fils de Saul, une œuvre unique qui nous plonge dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos à Auschwitz-Birkenau [ces «unités spéciales» constituées pour la plupart de prisonniers juifs forcés à travailler dans les chambres à gaz et les crématoriums des camps d'extermination, ndlr]. En épousant son point de vue et gardant la caméra fixée sur son visage, le film prouve qu'il est possible d'évoquer les camps dans la fiction sans tomber dans une représentation sordide.
Un dispositif inédit
The Zone of Interest, qui marque le retour de Jonathan Glazer dix ans après Under the Skin, est de ces œuvres indéniables, qui semblent annoncer un changement de paradigme dans la manière dont la fiction peut s'emparer d'un sujet. En compétition pour la Palme d'or au Festival de Cannes 2023, il met en place un dispositif inédit pour raconter toute l'horreur du système nazi, sans jamais franchir la ligne de l'indécence.
Le film débute avec une scène de simple pique-nique familial. Sauf qu'il s'agit de la famille de Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz-Birkenau, dont la coquette résidence est séparée du camp par un simple mur fleuri [et située dans ce périmètre alentour, qui était appelé «zone d'intérêt» par les nazis, ndlr]. Sans jamais pénétrer dans l'enceinte du camp, The Zone of Interest rend l'horreur palpable en suivant simplement le quotidien de la famille.
Lors de la conférence de presse du film à Cannes, samedi 20 mai, Jonathan Glazer cite une visite d'Auschwitz comme un des points de départ pour son projet: «J'étais stupéfait par la proximité de la maison et du jardin du commandant avec le camp.»
Hors-champ
Le rare mais talentueux réalisateur britannique s'est fait connaître avec des thrillers surnaturels et anxiogènes, notamment Birth et Under the Skin. Adapté du roman éponyme de l'écrivain britannique Martin Amis (dont le décès vendredi 19 mai a été annoncé le jour de la projection cannoise du film), The Zone of Interest est une expérience monumentale, bien plus terrifiante et malaisante que tout ce que le cinéaste avait pu précédemment réaliser.
«Il était important de ne pas montrer ces personnes comme des monstres. Ce sont des êtres humains qui ont infligé ça à d'autres êtres humains.» Jonathan Glazer, réalisateur du film The Zone of Interest, en conférence de presse
Dans le film de Jonathan Glazer, toute l'horreur se joue en hors-champ, mais le cinéaste ne nous laisse jamais l'oublier, en saturant chaque image de sinistres suggestions. Derrière le mur en béton qui délimite le jardin des Höss, on observe la fumée des fours et celle des trains qui défilent. Même dans une scène de dispute conjugale, située dans un cadre bucolique au bord de l'eau, on aperçoit des soldats qui patrouillent.
Le plus perturbant reste sans doute l'oppression sonore, créée par la compositrice Mica Levi alias Micachu (Jackie, Under The Skin) et le concepteur sonore Johnnie Burn. Toutes les scènes domestiques sont tapissées par les bruits de fond du camp, des machines, des cris des SS et des prisonniers.
Un film sans artifices de film
Pour produire cette expérience viscérale mais respectueuse, Jonathan Glazer a laissé de côté, autant que possible, les artifices classiques du cinéma. Le film a été tourné en Pologne, à Auschwitz: «Le film se passe en Pologne, les événements se sont déroulés en Pologne, je n'ai jamais envisagé de tourner ailleurs qu'en Pologne.» Il n'a par ailleurs utilisé aucune lumière artificielle et a tourné à distance, en installant des caméras dans chaque pièce en amont, pour laisser les comédiens évoluer seuls, sans équipe de plateau ni matériel de tournage.
La lumière crue, les plans fixes et les images digitales d'une netteté inéluctable pourraient presque rappeler une télé-réalité, créant un trouble d'autant plus profond qu'il nous place dans des codes visuels contemporains. L'absence du grain de la pellicule, ou de l'esthétisation que l'on peut parfois trouver dans certains films sur la période nazie (drapeaux, beaux costumes et symétrie à tout va), prive le public d'une distance rassurante avec l'horreur des événements.
Dans deux séquences, le film suit une des résidentes de la demeure qui, la nuit, cache de la nourriture sur les chantiers où les prisonniers sont forcés de travailler. Les scènes nocturnes ont été filmées à l'aide d'une caméra thermique, sans recours à la moindre lumière artificielle. La technique crée un effet infrarouge déstabilisant, dont la modernité tranche avec le sujet représenté. «On a essayé, tant que possible, de penser ce film au temps présent», explique le cinéaste.
Avec son chef décorateur, Jonathan Glazer a d'ailleurs tenu à utiliser des matériaux et des meubles neufs pour le tournage. «Cela fait partie de nos préjugés sur les films qui se déroulent à cette période, on s'attend à ce que tout soit vieux, mais évidemment à l'époque ça ne l'était pas.»
Aucune empathie pour les bourreaux
La manière dont le film dépeint la famille de Rudolf Höss est tout aussi radicale. Dans la fiction, peuplée par les antihéros et autres connards attachants, les nazis sont le plus souvent représentés comme des monstres machiavéliques et caricaturaux, ou bien comme des soldats ou bureaucrates empreints de remords, pris au piège d'une machine totalitaire qui les dépasse. Ni l'un ni l'autre dans The Zone of Interest: les Höss sont banalement humains, mais aussi sinistres, cruels et profondément antisémites. Sans aucun plan serré sur leur visage, le film les tient à distance et interdit la moindre connivence.
Au cours du film, Rudolf Höss est de plus en plus vampirisé par son travail –une obsession morbide tellement indigeste qu'elle finit par être littéralement régurgitée dans une scène ahurissante à la fin du film. Sa femme, elle, parle de leur résidence d'Auschwitz comme d'un lieu paradisiaque. «C'est la vie dont on a toujours rêvé, hors de la ville, avec tout à deux pas», argumente-t-elle, lorsque son mari lui propose de déménager.
«L'objectif du film est de montrer la capacité pour la violence qui existe en chacun de nous, a expliqué Jonathan Glazer lors de sa conférence de presse. Il était important de ne pas montrer ces personnes comme des monstres. Ce sont des êtres humains qui ont infligé ça à d'autres êtres humains. C'est très pratique d'essayer de nous distancier par rapport à eux, parce qu'on ne se comporte pas comme ça et on est sûrs qu'on ne se comporterait jamais comme ça. Mais je pense qu'on devrait en être un peu moins certains.»
Volontairement cauchemardesque, le film instille un malaise sidérant, dont on a du mal à se départir une fois les lumières rallumées. À Cannes, l'ampleur thématique du film est tellement imposante qu'elle a rendu l'idée d'une compétition avec d'autres films presque futile. Comme pour tout film tentant d'évoquer l'horreur d'Auschwitz, certains spectateurs préfèreront passer leur tour. Ce qui est certain, c'est que rarement une œuvre de fiction aura étudié de manière aussi puissante les limites de la narration pour capturer une horreur qui ne pourra jamais être entièrement comprise ou retranscrite.
Source: Slate.fr