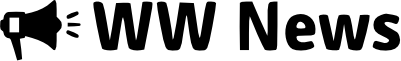Dans les manifestations, les banderoles des graffeurs de Black Lines en première ligne
Des manifestants tiennent une banderole signée Black Lines lors d’une manifestation contre la réforme des retraites à Paris, le 13 avril 2023. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
« Nous vivons pour marcher sur la tête des rois. » Jeudi 16 février, en tête de la manifestation contre la réforme des retraites, les black blocs déploient une banderole en noir et blanc. Dix mètres de large. La citation d’Henri IV, de Shakespeare, y encadre le dessin d’un homme accroupi et cagoulé, à mi-chemin entre l’imagerie postmédiévale et l’iconographie hip-hop. Quelqu’un émet alors l’idée de déplacer la banderole au milieu du cortège, « pour voir ». Immédiatement tout le « bloc », plus de mille personnes, vient se replacer de manière spontanée derrière elle. C’est là qu’ils constatent véritablement la force du symbole : la banderole comme étendard, l’art en point de ralliement.
Lire le décryptage : Article réservé à nos abonnés Le black bloc, expansion d’une tactique d’ultragauche controversée Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections Pour ajouter l’article à vos sélections
identifiez-vous S’inscrire gratuitement
Se connecter Vous possédez déjà un compte ?
« Ils », c’est Black Lines, un groupe qui, depuis 2018, a réuni plus de trois cents artistes et graffeurs pour réaliser de grandes fresques politiques résumables en quelques mots : justice sociale, justice climatique et antiraciste, et qui produit désormais la majeure partie des banderoles des black blocs. « Qu’un seul tienne, les autres suivront », « Notre révolte ne peut être dissoute », « Qui sème la hess [la misère] récolte le zbeul [le bordel] », accompagnées de dessins où s’affrontent autonomes et forces de l’ordre, où posent des militants sous leurs capuches et groupes de hyènes. « Une image classique, ce sont les animaux qui se battent contre le lion royal », décrypte l’un des auteurs.
Ils sont une quinzaine, assemblage hétérogène de 18 à 60 ans, à composer ces grandes bâches. Il y a Veneno, une jeune femme brune qui revient de trois années passées à Oaxaca, au Mexique, où elle a appris l’art de la gravure. Sa série de couples encagoulés qui s’embrassent sous la mitraille rappelle qu’il y a des rêves de lendemains et de plage sous les pavés. C’est elle qui a poussé pour passer de la fresque à la banderole. Il y a Vinci, à la culture militante, qui faisait déjà, lui, les banderoles du mouvement Justice pour Adama. Et puis deux frères chiliens ont apporté la tradition du muralisme qui raconte une histoire.
Enfin, bien sûr, il y a Itvan – et Lasc, son binôme de toujours – qui, sous le pseudo d’Arone, graffait, adolescent, sur les murs aveugles de Paris. Traits fins, timbre timide, regard doux, Itvan Kebadian a 37 ans. Passé par les Beaux-Arts de Bourges et de Nantes, le graffeur est aujourd’hui un artiste reconnu, avec une galeriste, Dominique Fiat, qui a pignon sur rue derrière le Musée Picasso à Paris. Or, c’est par lui que tout a commencé.
« Rapport symbolique »
Nous sommes en 2018. Cette année-là, le réalisateur d’origine arménienne Jacques Kebadian emmène pour la première fois Itvan et ses demi-frères, à Erevan. Pendant leur séjour, la population se soulève. L’armée ne tire pas parce que, s’enthousiasme le jeune homme, le 24 avril, c’est l’anniversaire du génocide. « A ce moment-là, j’ai compris que ce n’est pas le rapport de force mais le rapport symbolique qui fait les révolutions. » En France, on célèbre le cinquantenaire de Mai 68.
Il vous reste 66.1% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Source: Le Monde