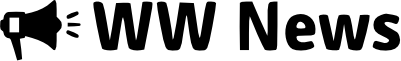Pourquoi les prix à la consommation ne baissent pas malgré le recul de ceux des matières premières
Un supermarché Casino à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), le 28 avril 2023. JEFF PACHOUD / AFP
Une baisse de 20 % en un an pour les céréales, de 15 % pour les produits laitiers, de 6 % pour la viande… C’est contre-intuitif pour quiconque a constaté la hausse des prix dans un supermarché, mais les cours mondiaux des produits alimentaires de base ont reculé au total de 20 % par rapport à avril 2022, selon les chiffres publiés vendredi 5 mai par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Avec le rétablissement des chaînes de production et de distribution, à la suite de la crise du Covid-19, et le retour à une consommation plus modérée après le dynamisme de la reprise, le rapport entre l’offre et la demande s’est rééquilibré. Et depuis près d’un an, l’Initiative céréalière de la mer Noire permet à l’Ukraine d’exporter à nouveau blé, tournesol et colza.
Pourtant, les prix de l’alimentaire ne diminuent pas – dans les rayons français, ils ont continué de renchérir, d’environ 15 % sur un an en avril. Et, selon les distributeurs, la tendance ne risque pas de faiblir : le patron de Système U, Dominique Schelcher, s’attend à une inflation sur un an atteignant « entre 23 % et 25 % sur l’alimentaire d’ici à la fin juin ».
Pour comprendre ce paradoxe, remontons la chaîne depuis les linéaires des grandes surfaces jusqu’aux cours des matières premières sur les marchés financiers, en passant par les négociations entre industriels et distributeurs et la gestion des stocks par ces derniers.
Des prix établis par des contrats fixes
Comme pour le gaz, il y a un décalage entre les prix de gros, en général fixés au niveau mondial sur les marchés financiers, et les prix de détail, plus souvent nationaux – et établis, en France, par les négociations avec la grande distribution.
De fait, qu’il s’agisse des petits agriculteurs ou des géants de l’agroalimentaire, les producteurs sont liés aux distributeurs par des contrats assez rigides, négociés une fois par an, en mars. Ce pourrait être deux fois cette année : le ministère de l’économie a instamment demandé aux acteurs un retour à la table des négociations avant l’été afin que les réductions de prix qui en résulteraient « soient restituées aux consommateurs ».
Ces contrats annuels protègent les distributeurs et les consommateurs des variations, à la hausse comme à la baisse. Ils épargnent aux consommateurs une flambée des cours lorsqu’elle survient – par exemple, le blé tendre, variété qui sert à faire de la farine, avait augmenté de 79 % entre janvier 2020 et juillet 2022 ; heureusement la farine n’a pas augmenté dans les mêmes proportions, avec une hausse moins forte et plus progressive de l’ordre de 20 % sur la même période. Mais ces contrats ont aussi pour effet de ne pas permettre aux consommateurs de profiter immédiatement de la décrue actuelle. Alors que les cours mondiaux des huiles végétales ont reculé de près de 48 % entre mars 2022 et mars 2023, les prix sur les étiquettes ont eux augmenté dans la même proportion.
Après avoir pressé les distributeurs de faire leur part dans la lutte contre l’inflation, Bercy insiste désormais auprès des industriels sur « la logique de réversibilité à laquelle ils s’étaient engagés en avril 2022 ». A l’époque, ils avaient pu renégocier en cours d’année avec les distributeurs pour répercuter les hausses des matières premières qu’ils subissaient à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les lois EGalim, qui ont ouvert la possibilité de rediscuter les prix en cas de variations importantes des cours des matières premières, permettraient aujourd’hui de rejouer le match.
Les industriels, eux, jugent qu’il est un peu tôt pour parler de reflux des prix alors qu’ils subissent encore des charges très importantes, étant liés par des contrats sur plusieurs mois, voire sur une année, avec leurs fournisseurs de matières premières, d’engrais, d’emballages, d’énergie… Jean-Philippe André, président de l’Association nationale des industries alimentaires, décrit ainsi le dilemme : « Si vous avez acheté des matières premières à un prix élevé, et que vous les avez dans vos stocks pendant un, deux ou trois mois, vous ne pouvez pas accélérer le phénomène de sortie de vos stocks », en les bradant, en somme. « Ce serait suicidaire. »
Un délai pour transmettre les variations de prix
Imaginons, malgré ses réticences, que l’industrie accepte tout de même de débattre à nouveau de ses tarifs. Un round de négociation entre les commerciaux de l’agroalimentaire et les acheteurs de la distribution dure environ trois mois. Ensuite, si la discussion aboutit à des baisses de prix, ces dernières ne s’appliqueront pas tout de suite ; elles s’étaleront au fur et à mesure de l’écoulement des stocks des distributeurs.
Il faut compter « entre deux et trois mois de mise en œuvre, car la répercussion se fait au fur et à mesure du renouvellement des stocks dans les rayons », confirme Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, qui représente les enseignes. Concrètement, si les moyennes et grandes surfaces ont constitué des réserves importantes de certains produits et-ou que les acheteurs se font plus rares, les stocks aux anciens prix mettront plus de temps à céder la place aux nouveaux.
« Les cours sur les marchés mondiaux se transmettent avec retard au reste de la chaîne de production », explique Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l’Insee. En général, il faut deux à trois trimestres pour voir les effets d’une variation forte des matières premières sur les étiquettes, estime l’expert.
Un prix qui ne dépend pas seulement des matières premières
Certes, les cours mondiaux de matières premières ont nettement reflué ces derniers mois, mais, si l’on reprend l’indice FAO, ils demeurent toujours 12 % au-dessus de leurs niveaux de janvier 2021. De surcroît, les cours des matières premières sur les marchés financiers ne sont qu’un des paramètres de l’équation. Dans la formation des prix, les producteurs doivent en effet tenir compte de plusieurs éléments, tous mouvants, de façon plus ou moins prévisible : le prix des emballages, du transport, du stockage… et surtout les coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre. Dans certains secteurs, comme le maraîchage, la main-d’œuvre représente près de la moitié des charges. Or, le smic a progressé de 12 % depuis 2021.
S’agissant de l’énergie, il y a effectivement un reflux des cours du gaz et de l’électricité. Mais ça ne veut pas forcément dire que toutes les entreprises ont des coûts énergétiques en baisse. Parce que, explique Julien Pouget, « ça dépend de leur contrat et du moment où elles ont dû le renégocier quand il arrivait à échéance. S’il était à prix fixe sur une durée contractuelle, et qu’il a expiré à la fin de l’été 2022, il a fallu le renégocier dans des conditions assez défavorables, puisque les prix étaient très élevés. »
Parmi les dépenses incompressibles et difficiles à piloter, pour la majorité des exploitations agricoles, la fourniture en intrants, semences et engrais. Or, le prix des engrais – dont une large part est fabriquée avec du gaz – a plus que doublé en deux ans.
C’est ce qui explique, pour moitié, l’augmentation du prix de vente côté agriculteurs, a calculé l’Inspection générale des finances, qui s’est penchée sur les marges des différents maillons de la chaîne – l’autre moitié a profité aux exploitants qui ont amélioré leurs revenus, parmi les plus faibles en France.
Source: Le Monde